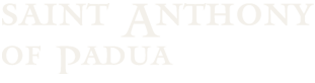La Providence, une confiance dans la prière
« Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, mon présent à ton amour, mon avenir à ta Providence. » Cette citation de saint Padre Pio est une prière de confiance en Dieu. Confiance pour le passé et pour le présent, mais aussi confiance dans un avenir laissé entre les mains de la Providence. Cette prière fait ainsi écho à celle d’un autre saint, François de Sales : « Il faut que notre foi soit fondée sur l’infinie bonté de Dieu (…) et nous tout abandonner, sans aucune réserve, à la Providence. »
Mais si ces deux saints exhortent à s’en remettre à la Providence, de quoi s’agit-il vraiment ? La Bible n’est pas de la plus grande aide pour mieux comprendre. Le terme n’y apparaît qu’à deux reprises, dans l’Ancien Testament, toutes deux dans le Livre de la Sagesse : « C’est ta providence, ô Père, qui tient la barre, car tu as ouvert un chemin dans la mer, un sentier sûr au milieu des flots » (Sg 14, 3) et « Des gens sans loi, qui prétendaient asservir une nation sainte, se retrouvaient enchaînés par les ténèbres ; prisonniers d’une longue nuit, comme enfermés sous un toit, bannis de la providence éternelle, ils gisaient » (Sg 17, 2). Ressort encore l’idée d’une protection du Seigneur dans la confiance.
« Providence, nom féminin : Sagesse qui prévoit et pourvoit », affirme le dictionnaire de l’Académie française. Avant d’ajouter : « Théologie : Suprême sagesse par laquelle Dieu conduit et ordonne toutes choses. ». Puisqu’il s’agit d’un terme théologique, poursuivons les recherches du côté du Catéchisme de l’Église catholique : « La création a sa bonté et sa perfection propres, mais elle n’est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement (in statu viae) vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l’a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. » (CEC 302)
Collaborateurs
Le texte poursuit de façon moins aride : « la sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate, elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu’aux grands évènements du monde et de l’histoire » (CEC 303). Mais le texte continue encore, non sans ajouter une certaine confusion : « Aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de “soumettre” la terre et de la dominer » (CEC 307).
Youcat, le catéchisme dédié aux jeunes, est un peu plus explicite. « La providence, c’est l’action et la bienveillance de Dieu envers sa Création, son souci de la conduire vers sa perfection, là où certains ne voient que l’effet du hasard », est-il expliqué. La Providence apparaît donc comme l’œuvre de la bonté de Dieu. Mais la Providence est-elle alors une direction imposée au monde et aux hommes par Dieu ? Dans ce cas, comment l’homme peut-il être libre, si la Providence trace déjà la marche du monde ? Et comment peut-il « participer librement » à cette marche ?
Youcat n’ignore pas la question. « Pour autant, Dieu n’est pas un « activiste » qui fait tout, tout seul ! Il passe par ses créatures pour accomplir son dessein. C’est là un signe de sa grandeur et de sa bonté : non seulement il nous donne d’exister, mais il nous donne aussi la dignité et la liberté d’agir par nous-mêmes et de collaborer avec lui. » Et de résumer : « Providence ≠ destin car nous ne sommes pas des marionnettes ou des robots ! ».
La Providence apparaît alors comme l’accompagnement bienveillant de Dieu du monde et de chacun sur le chemin de la sainteté. Comme le Christ ressuscité avec les pèlerins d’Emmaüs, la Providence parcourt les chemins avec chacun, sans imposer mais en soutenant et accompagnant. C’est une proximité bienveillante et non un ordre donné, fût-il pour une cause bonne.
Le mystère du mal
Et là réside peut-être le plus grand mystère de la Providence : elle accompagne toujours, même dans le mal. « Même à travers les drames du mal et du péché, Dieu [conduit] sa création jusqu’au repos de ce Sabbat définitif, en vue duquel il a créé le ciel et la terre », assure le Catéchisme (CEC 314). Ainsi, « du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens : la glorification du Christ et notre Rédemption » (CEC 312).
« Dieu ne permet le mal que parce qu’il peut en tirer un bien, résume Youcat. Comment ? Nous ne connaîtrons pleinement ce mystère que lorsque que nous vivrons en Dieu, dans la vie éternelle. Ici-bas, les chemins de la Providence nous sont souvent inconnus. » Ainsi, s’il est possible d’essayer de comprendre vraiment ce qu’est la Providence, elle reste un mystère, c’est-à-dire, selon la définition donnée par les évêques de France, une vérité de la foi qui « n’est pas contraire à l’intelligence et à la raison, mais qui en dépasse les limites ». C’est une « vérité inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaître en se révélant ».
La confiance en la providence est donc une prière : si elle peut être abordée par la raison, elle se dévoile toujours plus dans la foi. C’est par l’abandon confiant à Dieu, que cette « sagesse qui prévoit et pourvoit » – pour reprendre les mots de l’Académie française – peut s’aborder. Et pour le croyant, c’est une promesse : Dieu est présent, même au cœur du mal et ordonne toute chose vers le bien. Et ainsi, comme l’affirmait le pape Benoît XVI lors de l’audience générale du 27 février 2011, « la foi dans la providence, en effet, ne dispense pas de la lutte difficile pour une vie digne, mais libère de l’anxiété pour les choses et de la peur du lendemain. »