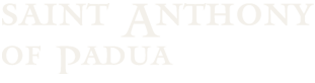En prison, le mystère du Salut
« Pour offrir aux détenus un signe concret de proximité, je désire ouvrir moi-même une Porte sainte dans une prison afin qu’elle soit pour eux un symbole qui invite à regarder l’avenir avec espérance et un nouvel engagement de vie. » C’est par ces mots que le Pape a expliqué le choix du lieu pour la seule porte jubilaire située hors des quatre basiliques majeures romaines : dans la prison de Rebibbia. « J’ai voulu ouvrir en grand la Porte ici aujourd’hui [...] : la grâce d’un Jubilé est d’ouvrir grand, d’ouvrir et, surtout, d’ouvrir les cœurs à l’espérance », a-t-il souligné le 26 décembre dernier aux détenus de ce centre pénitentiaire romain.
Ouvrir les cœurs à l’espérance : telle est la mission – et encore plus pendant ce Jubilé 2025 – des aumôniers de prison et des acteurs de la pastorale carcérale. « La première mission est d’être auprès des détenus et d’espérer avec eux », explique Brigitte, qui a été auxiliaire d’aumônerie à la prison de la Santé à Paris pendant une dizaine d’année.
Comment espérer avec ceux qui n’ont que des murs pour horizon et l’isolement pour avenir ? « La première ouverture d’espérance, c’est justement d’être là avec eux », veut croire le frère Henri Namur. De 2011 à 2016, il a été aumônier de la prison de la Santé puis de celle de Fresnes, à l’appel de son provincial et du cardinal André Vingt-Trois – alors archevêque de Paris – qui voulait spécialement un franciscain pour cette mission.
« Là pour eux »
Lorsque le frère provincial lui propose cette mission, il est d’abord hésitant. « Comment vais-je pouvoir rentrer dans cet univers qui fait peur avec les barbelés et les cris que l’on entend de l’extérieur ? », se demande-t-il alors, passant près de la prison de la Santé, située non loin du couvent des franciscains à Paris. La réponse lui est venue dès le lendemain matin : « À l’oraison, nous avions ce matin-là la parole d’Isaïe reprise dans l’évangile de Luc : ‘‘L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés.’’ » (Lc 4, 18).
Cette bonne nouvelle s’incarne d’abord par des gestes, détaille-t-il. Par exemple, « bien que l’aumônier ait les clefs des cellules, il frappe à la porte avant d’entrer : les détenus savent ainsi que c’est lui, et cela les met en situation d’avoir à recevoir l’aumônier, ce qui leur rend une dignité ». Et le frère Henri de poursuivre : « Dans un monde violent, de bruit jour et nuit, cela permet de restituer un peu d’humanité ».
En recevant l’aumônier, en allant à la messe ou en partageant des temps d’aumônerie avec d’autres détenus, abonde Brigitte, les détenus peuvent « retrouver une dignité et une raison d’être ». Car par leur présence – « croyants ou non, ils savent que le Padre est là pour eux » – leurs gestes et leurs mots, les intervenants pastoraux viennent leur apporter une promesse : « Ils ne sont jamais les derniers, car quelqu’un a accepté de l’être à leur place pour qu’ils ne succombent pas à la désespérance : le Seigneur », insiste le franciscain.
Dieu présent
Cette promesse s’adresse aussi aux acteurs pastoraux, qui se retrouvent ainsi confrontés au mal commis par d’autres. « Il y a une terreur inhérente à la prison : on entend, on reçoit des choses très violentes », confie Brigitte, qui assure cependant ne jamais s’y être sentie en danger. « Jamais je n’ai été aussi loin dans le mystère du mal », souffle de son côté le frère Henri.
Mais il ne s’arrête pas là. « De même, je n’ai jamais été aussi loin dans le mystère de notre salut : jusqu’où Jésus est allé pour nous sauver et de quoi il nous sauve », ajoute-t-il aussitôt. Le religieux se souvient notamment d’un dictateur hispano-américain incarcéré à la Santé lorsqu’il y exerçait et qui assistait fréquemment à la messe. « Je le voyais participer à l’eucharistie mais je ne pouvais pas ne pas penser aux victimes exécutées sous son pouvoir, sur ses ordres, confie-t-il. L’aumônier de prison doit laisser cohabiter ces deux mystères : celui du mal commis et celui de Dieu présent pour l’auteur de ce mal. » Et pour cela, il faut lier à la fois « le travail de vérité et celui de miséricorde, en prenant les personnes là où elles sont, avec leur part de vérité à elle ».
L’aumônier de prison n’est donc là ni pour faire ou faciliter le travail de la justice, ni pour se ranger systématiquement du côté du détenu. Cela lui donne une position tout à fait spéciale, d’autant qu’il peut recevoir des lettres cachetées des détenus et même, si l’aumônier est prêtre, entendre leur confession. « Il faut savoir entendre leur souffrance, en étant dans l’empathie tout en gardant une juste distance », détaille Brigitte. Et le tout, rajoute le frère Henri, sans oublier la « vie difficile » des services pénitentiaires, au milieu desquels ce service s’exerce et avec lesquels il faut donc établir des relations de confiance.
Pour les différents acteurs, la pastorale en milieu carcéral signifie accepter d’entrer dans une proximité avec le mal commis. « J’aurais aimé être accompagné, pouvoir évacuer la violence reçue », glisse ainsi l’ancienne agente pastorale. Leur foi en ressort cependant bouleversée. « Il est très touchant de voir combien ils se sentent concernés par les Écritures et de les voir ouvrir les yeux à leur lecture », reprend l’ancienne auxiliaire d’aumônerie. « Voir jusqu’où le Seigneur est capable d’aller a construit une foi très profonde en moi, indique le frère Henri. L’amour ne désespère pas et relève dès que l’homme se tourne vers le Seigneur. »